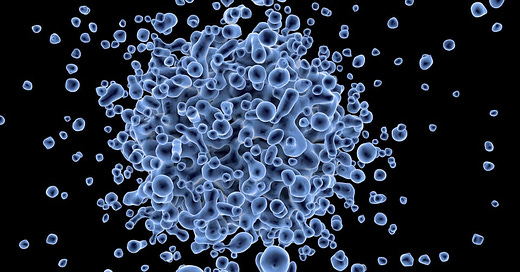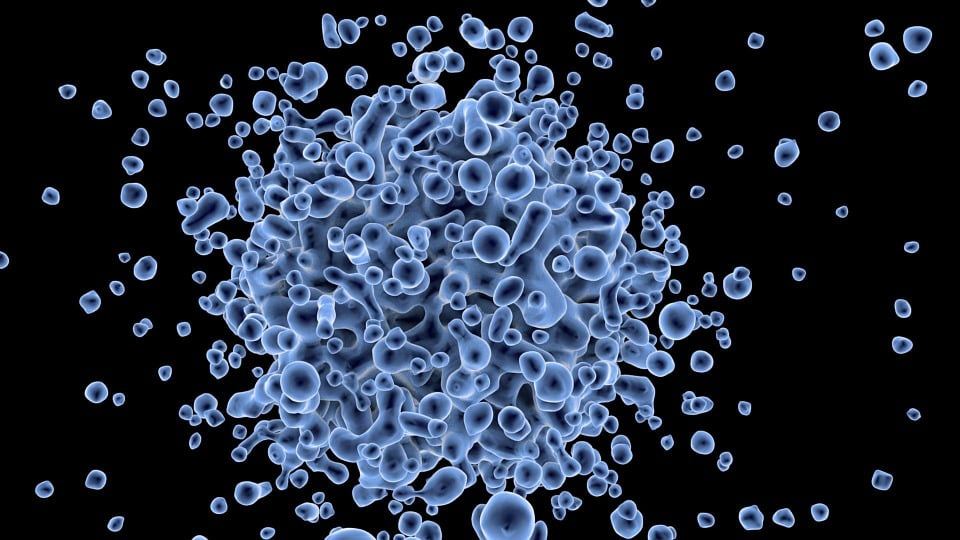2. Les idées, on en débat. Les tumeurs, on les éradique.
L'infolettre ONGBS du 28 août 2024
Bienvenue dans la nouvelle rubrique L’Observatoire national du gros bon sens, dans laquelle chaque semaine, le mercredi, je souligne la publication d’un ou de plusieurs textes s’étant démarqués par leur gros bon sens. Cette semaine, le gros bon sens, c’est aussi qualifier ses opposants politiques et idéologiques de maladie.
Docteur, suis-je normal?
Comme le disais l’universitaire, haut fonctionnaire et homme politique français Jean-Michel Blanquer, « Il faut un diagnostic juste si l’on veut des remèdes appropriés ». Et qui de mieux pour donner un diagnostic juste qu’un docteur? Et ça, le Journal de Montréal en a quelques-uns à sa disposition.
En société, il est essentiel de faire l’effort « de comprendre ceux qui ne pensent pas comme nous », comme a sagement écrit Dr Mathieu Bock-Côté dans une chronique sur Kamala Harris la semaine dernière. En effet, « ils ont peut-être tort, mais ils n’appartiennent pas à une race méprisable à l’écart de l’humanité ».
Toutefois, la gauche canadienne déroge de cette règle. Elle n’est pas seulement une race méprisable à l’écart de l’humanité, mais bien quelque chose de complètement étranger à l’humanité telle qu’on la conçoit: c’est une maladie.
Le Canada, un pays malade
Cette semaine, le conflit au CN/CPKC a explicité avec véhémence ce que Dr Francis Gosselin appelle « la maladie canadienne ». En effet, les éléments de cette maladie sont 1) que « deux entreprises [..] se partagent tout le marché, choisissant en toute impunité de bloquer tout le pays », et 2) « l’absence criante de courage de la part d’élus qui n’ont plus la moindre conviction, paralysés face à ce conflit qui tient le continent nord-américain en otage, quelques mois à peine après l’expiration des conventions collectives ». Il s’agit là de « la recette parfaite de cette pathologie ». Ce « syndrome » est également pratiquement « chronique », revenant d’année en année.
Bien que Dr Gosselin ait tracé les grandes lignes de cette maladie canadienne, il faut toutefois donner le crédit à Mario Dumont pour avoir souligné les impacts tangibles que cette maladie peut avoir chez le patient touché. Il s’agit essentiellement d’une « récurrence des paralysies» qui peuvent ultimement entrainer des pertes de revenu considérables, mais surtout des impacts liés à la réputation du patient. Tels les lépreux avant l’arrivée du Christ dans le film de Pâques classique Ben-Hur, être atteint de cette maladie canadienne signifierait une ostracisation de la part de ses pairs ainsi qu’une mise au ban de la société. Une situation que l’on ne souhaite à personne.
Mais il est possible de trouver la cause de cette maladie canadienne afin de, éventuellement, mieux pouvoir la traiter. Mario Dumont y va d’un récit envoutant pour illustrer son point: «Imaginons le pauvre fournisseur canadien expliquer ses retards à répétition: “Excuse-moi, c’est parce que là, les Autochtones manifestent sur le rail.” “Excuse-moi, les camionneurs ont bloqué le pont”. “Excuse-moi, les travailleurs ici et là sont en grève.” À un point, l’acheteur va lui dire: “Excuse-moi, mais tu me rappelleras lorsque ton pays sera fonctionnel!” Et il va se retourner vers un autre fournisseur.» Après avoir imaginé cette situation tel que réclamé par Mario Dumont, le nœud du problème, qui rend le pays dysfonctionnel, ne peut que nous apparaître devant les yeux telle une évidence: c’est le droit à la grève et le droit de manifester.
Le wokisme, un cancer
Un autre diagnostic médical a été posé cette semaine, non pas du point de vue économique cette fois, mais du point de vue idéologique. Il avait en effet été établi par Richard Martineau, il y a environ 2 ans, que le wokisme était ni plus ni moins qu’une « maladie mentale ». Mais voilà qu’une contre-expertise (du moins, une expertise complémentaire) ne qualifie pas le wokisme de maladie mentale, mais bien de tumeur cancéreuse. Et il n’est pas facile d’« éradiquer la tumeur». Ce constat est basé sur la « science disponible » (où? À vous de la trouver puisque non référencée) qui montrerait qu’il n’y a aucun impact positif aux politiques d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI). « Ce serait même plutôt le contraire. Ces politiques alimenteraient le ressentiment, la méfiance et la crainte ».
Cette expertise, gracieuseté du Dr Joseph Facal, n’entre pas en contradiction avec les paroles de sagesse du Dr Bock-Côté évoquées en introduction, qui stipulaient que « la politique, normalement, ne met pas en scène le bien contre le mal, mais deux conceptions contradictoires de la cité, et que si on est en droit de préférer l'une à l’autre, on doit quand même chercher à comprendre ses adversaires ». Il faut en effet débattre avec ses adversaires politiques. Mais quel idiot débattrait avec une maladie? Une maladie, surtout une tumeur, on l’« éradiqu[e] ».